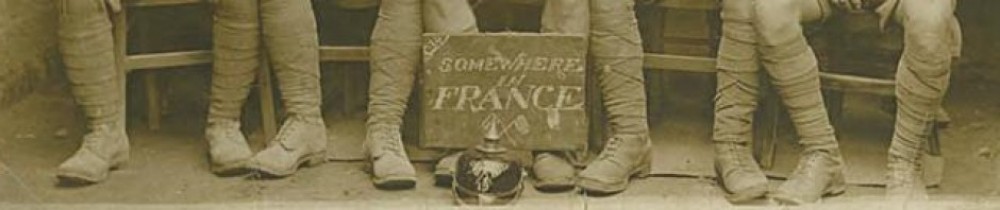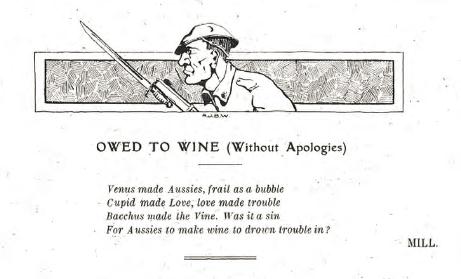Hannah Leal
“The horse was ever the friend of man, but never did he aid his masters so effectively as in the war which has just ended.” Aussie magazine

Sketch of a Light Horseman, from The Kia Ora Coo-ee, December 15, number 6, page 6. University of Melbourne Archives, Harrison Family collection, 1978.0119, item 4/1
Un dicton commun est que le chien est le meilleur ami de l’homme, mais en temps de guerre, la phrase a besoin de changer. Pendant la guerre, c’est le cheval qui est le meilleur ami du soldat.
Les chevaux ont joué un rôle important pendant la première guerre mondiale. Les chevaux ont été utilisés au combat, afin de permettre aux soldats de rejoindre et de quitter rapidement les conflits, ils ont aussi servi à transporter des pièces d’artillerie, des messages et des troupes à travers des terrains variés, pour tirer les wagons d’approvisionnement et pour les ambulances. 136000 chevaux australiens ont servi pendant la Première Guerre mondiale.
On peut voir l’importance des chevaux dans “History of the Ninth Australian Field Ambulance” et “Aussie”.
History of the Ninth Australian Field Ambulance
Cette unité d’ambulance était chargée de fournir des services médicaux aux blessés. Le document décrit l’expérience de l’unité pendant la première guerre mondiale et souligne le rôle important que les chevaux ont joué dans le service ambulancier.
Les chevaux tiraient les wagons qui transportaient des blessés sur des distances qui auraient été trop grandes pour que des soldats les transportent. Pour permettre aux chevaux d’atteindre les bases médicales, le document décrit la nécessité de créer des chemins de transport spécifiquement adpatés aux chevaux.
Cette publication décrit également une anecdote amusante impliquant des australiens de l’unité et des chevaux allemands. Deux chevaux allemands ont été “souveneered” par des soldats australiens (c’est à dire, gardés en souvenir) sachant que ce vol affaiblirait les Allemands et fournirait une aide précieuse aux Australiens. Ces chevaux ont été nommés par les australiens “Fritzy” et “Fraulein”. Ils ont été ensuite utilisés par les australiens pour déplacer l’équipement et les wagons non sans difficultés car les chevaux allemands ne comprenaient pas les commandes en anglais.
Aussie
Il y a une section dans ce magazine sur les différentes unités australiennes. Le “Australian Veterinary Hospital”, était une unité qui s’occupait de chevaux blessés.
Tandis que les soldats qui ont survécu à la guerre ont été appelées héros, beaucoup de “poor dumb beasts”, dont l’aide avait été “so valuable … that it is doubtful whether the result could have been what it was without them”, ont été tués en raison de blessures et de privations. Toutefois, pendant la guerre, en raison du rôle important que les chevaux avaient, des hôpitaux vétérinaires ont été construits pour soigner les chevaux blessés ou “nursed back to strength – and duty”. Le “Australian Veterinary Hospital” était l’un de ces hôpitaux, où 500 soldats ont travaillé dans des installations pour 1250 “patients”. Pendant les 18 mois que l’hôpital a existé, 25000 chevaux ont été traités. “Aussie” souligne l’importance du rôle des chevaux pendant la guerre en disant des soldats qui travaillaient à l’hôpital qu’ils faisaient un travail noble et privilégié et que le traitement des chevaux n’était pas moins essentiel que le traitement des soldats humains.
Bibliographie
Aussie, No. 11, February 1919. University of Melbourne Archives, Ray Jones collection.
A History of 9 Field Ambulances. Retrieved from http://www.raamc.org.au/
History of the Ninth Australian Field Ambulance. University of Melbourne Archives, Ray Jones collection.
Horses used in the First World War (Walers). Retrieved from http://www.awm.gov.au/
McAloon, C. (2010, April 21). Remembering old war horses. ABC, retrieved from http://www.abc.net.au/
The Australian Light Horse. Retrieved from http://www.lancers.org.au/